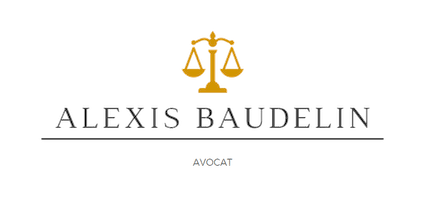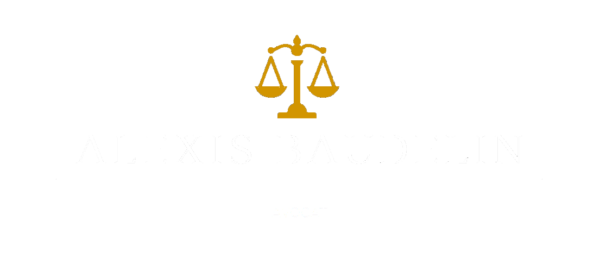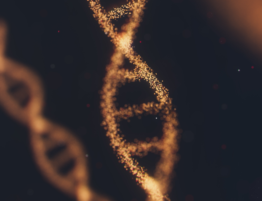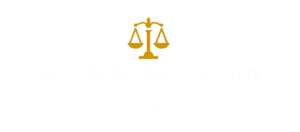Crédit photo Chris Charousset
Affaire des décrocheurs de portraits – La Cour de cassation répond en faveur de la liberté d’expression et rejette l’état de nécessité
Peut-on désobéir à la loi et commettre un vol si celui-ci vise à alerter sur l’urgence climatique ? C’est la question sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée le 22 septembre 2021 par deux arrêts (n°20-80.489 et n°20-85.434).
Pour un bref rappel historique, le mouvement écologiste ANV-COP21 a initié début 2019 une série d’actions de désobéissance civile visant à se rendre dans les mairies pour y décrocher les portraits d’Emmanuel Macron. Ces actions ont été menées en réaction au manque d’ambition du gouvernement alors qu’un recours juridique était déposé contre l’État pour « inaction face au changement climatique » par quatre organisations : l’Affaire du Siècle.
En décrochant le portrait officiel du président Macron dans les mairies, et en laissant des murs vides à la place, les activistes d’ANV-COP21 pointaient « l’absence d’une réponse adaptée du gouvernement face au péril climatique et à l’urgence sociale et dénoncent la faillite de l’État à son rôle de protection de la population. »
Les actions #DecrochonsMacron sont lancées le jeudi 21 février 2019 en simultanées à Paris, Lyon et au Pays Basque et les activistes s’emparent de plusieurs portraits du président. Au total, plus d’une centaine de portraits seront décrochés dans toutes les mairies de France pendant l’année 2019 et plusieurs d’entre eux seront brandis à l’occasion de divers évènements : Marche des portraits pendant le G7, rassemblement devant la tour Eiffel à J-100 des municipales ou encore marche jusqu’à l’Élysée le 13 mars 2020 pour dresser « le vrai bilan du gouvernement Macron ».
Le gouvernement n’a pas tardé à réagir à ces décrochages de portrait et une série d’enquêtes et d’interpellations ont été menées conduisant les activistes climatiques devant la justice. A Paris, Lyon, Auch, Valence, Strasbourg, Amiens ou encore Bordeaux, au total plus d’une quarantaine de procès se sont tenus et autant d’occasions pour les activistes d’évoquer l’urgence climatique et de faire reconnaître la nécessité de ce type d’actions de désobéissance civile.
Autant de procès, autant de tribunaux saisis et autant de jurisprudences potentielles pouvant conduire soit à des condamnations soit à des relaxes. Si la plupart des juges sont restés frileux sur le sujet, d’autres ont fait preuve d’audace en retenant l’état de nécessité ou la liberté d’expression pour relaxer des activistes. Il était donc inévitable que la Cour de cassation soit saisie pour trancher les divergences des tribunaux.
Les deux arrêts de la Cour de cassation du 22 septembre sont riches d’enseignement. Bien que le juge judiciaire suprême réfute la possibilité d’invoquer l’état de nécessité pour justifier le vol des portraits présidentiels (I), il confirme l’argument émergent de la liberté d’expression comme moyen de défense de la désobéissance civile (II). On notera également une prise de position claire sur l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement ADN dans le contexte d’actions politiques et militantes (III).
I – Le rejet de l’état de nécessité comme fait justificatif de l’infraction
1 – Une création prétorienne
L’état de nécessité est une création prétorienne en matière pénale qui permet de justifier que certains actes délictueux soient commis en vue de la préservation d’un intérêt supérieur, que ce soit la protection d’une personne ou d’un bien.
Parmi les premières affaires où l’état de nécessité fut invoqué, on peut citer la célèbre affaire Ménard du 22 avril 1898 dans laquelle le juge Magnaud, président du tribunal de Château-Thierry avait relaxé Louise Ménard pour un vol de pain dans une boulangerie. Le juge avait présenté Louise comme une bonne mère famille, laborieuse et décrivait la misère dans laquelle elle se trouvait tout en rejetant la responsabilité du vol sur la mauvaise organisation de la société.
2 – La consécration de l’état de nécessité dans le code pénal
Il faudra attendre l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994 pour que l’état de nécessité soit consacré par le législateur dans un texte de portée générale.
L’état de nécessité est désormais inscrit à l’article 122-7 du Code pénal dans les termes suivants :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Au vu de ce texte, l’état de nécessité ne peut être valablement invoqué que si plusieurs conditions sont réunies :
- L’infraction doit avoir été commise face à un danger actuel ou imminent
- L’infraction doit être nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur
- L’infraction était nécessaire dans la mesure où elle était le seul moyen d’éviter le danger
- L’infraction était proportionnée à la gravité de la menace
3 – L’invocation régulière de l’état de nécessité par les mouvements écologistes
Si l’on retrouve habituellement ce fait justificatif dans des affaires en lien avec la misère, la nécessité de se nourrir et de se loger dignement, les mouvements écologistes s’en sont saisi plus récemment pour défendre leurs actions.
Les « faucheurs d’OGM » ont usé abondamment de cette stratégie et parfois avec succès. Ainsi, le 17 décembre 2020, le tribunal judicaire de Perpignan a relaxé un faucheur volontaire d’OGM sur le fondement de l’état de nécessité alors que ce dernier avait détruit des plants de tournesols génétiquement modifiés. Le tribunal avait estimé que l’action de fauchage était « commandée par la nécessité de protéger des intérêts généraux essentiels immédiatement mis en danger par cette culture, sans que la protection des intérêts pécuniaires des auteurs de cette plantation ne puissent être utilement opposés aux intérêts défendus par le prévenu » [1].
De même, le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a relaxé des prévenus poursuivis pour avoir dégradé des bidons de désherbants contenant du glyphosate dans plusieurs magasins. Le tribunal a notamment considéré en s’appuyant sur des études scientifiques que le danger du glyphosate est établi et que « cette action nécessaire visant à informer la population ainsi que les responsables des magasins en cause, face à ce danger particulièrement insidieux, répond à l’exigence de proportionnalité exigée par la notion d’état de nécessité » [2].
En ce qui concerne les décrocheurs de portrait on retiendra un jugement audacieux du tribunal de grande instance de Lyon du 16 février 2019 qui avait relaxé les militants du chef de vol en réunion sur le fondement de l’état de nécessité en considérant notamment que « dans l’esprit de citoyens profondément investis dans un cause particulière servant l’intérêt général, le décrochage et l’enlèvement sans autorisation de ce portrait dans un but voué exclusivement à la défense de cette cause, qui n’a été précédé ou accompagné d’aucune autre forme d’acte répréhensible, loin de se résumer à une simple atteinte à l’objet matériel, doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple » [3]. Ce jugement a cependant été infirmé en appel puis a donné lieu à l’un des pourvois en cassation qui intéresse la présente affaire.
4 – Le rejet de l’état de nécessité par la Cour de cassation dans le cas des décrocheurs de portraits
L’arrêt de la Cour de cassation est assez laconique sur ce rejet et il ne sera pas excessif de retranscrire les deux petits attendus à ce sujet :
« Pour rejeter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité invoqué par les prévenus, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’existe aucun élément qui permette de considérer que le vol des portraits du président de la République dans des mairies soit de nature à prévenir, au sens de l’article 122-7 du code pénal, le danger climatique qu’ils dénoncent.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d’insuffisance, répondant à l’ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu’il n’était pas démontré que la commission d’une infraction était le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision. »
En substance, la Cour de cassation a estimé que le juge du fond avait correctement expliqué les raisons pour lesquelles l’état de nécessité ne pouvait être invoqué comme fait justificatif de l’infraction. Aucun élément ne permettait de considérer que le vol des portraits présidentiels était de nature à prévenir le danger climatique énoncé et qu’il s’agissait du seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent.
Il convient de remarquer que la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’existence d’un danger climatique actuel ou imminent. Elle va même jusqu’à considérer les arguments des prévenus comme péremptoires en ce qu’ils ne démontraient pas que l’infraction était le seul moyen d’éviter un péril actuel ou imminent.
Cette position peut apparaître critiquable notamment en ce que le juge judiciaire ne souhaite pas prendre position sur l’existence d’un danger actuel ou imminent résultant de l’urgence climatique. La satisfaction de cette condition énoncée à l’article 122-7 du code pénal n’est donc pas présumée et il convient aux prévenus d’insister sur ce point par une démonstration systématique.
La position de la Cour de cassation était en revanche plus ou moins attendue en ce qui concerne le défaut de lien entre le décrochage des portraits et le péril actuel ou imminent que cette action de désobéissance civile permettait d’éviter.
Toutefois, l’action des décrocheurs de portrait n’était pas vaine dans la mesure où elle a permis de confirmer la voie d’un autre fait justificatif : celui de l’exercice de la liberté d’expression.
II – L’émergence de la liberté d’expression comme moyen de défense de la désobéissance civile
1 – Une jurisprudence annoncée par la Cour européenne des droits de l’Homme
La jurisprudence permettant de se défendre d’une infraction au titre de la liberté d’expression a émergé progressivement notamment sous l’influence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le juge de Strasbourg a condamné à plusieurs reprises la France pour avoir initié des poursuites à l’encontre de personnes ayant commis des infractions dans l’exercice de leur liberté d’expression.
À titre d’exemple, dans un arrêt du 14 juin 2013, Eon c. France, la Cour avait condamné la France violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour avoir infligé une amende symbolique de 30 euros avec sursis à la personne qui avait injurié le chef de l’État Nicolas Sarkozy[4].
Les juridictions françaises et la Cour de cassation se sont ensuite emparées de cette jurisprudence pour en déduire un fait justificatif en matière pénale.
Ainsi, dès 2016, la Cour de cassation faisait échec aux poursuites exercées à l’encontre d’une personne ayant commis le délit d’escroquerie au motif que son incrimination constituait une ingérence disproportionnée à la liberté d’expression[5].
Plus récemment, la Cour de cassation a jugé que le délit d’injure ne pouvait être réprimé, bien qu’il soit entièrement caractérisé, en raison de « l’exigence de proportionnalité [qui] implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression »[6].
Cette solution, que la Cour de cassation semblait réserver aux journalistes et aux infractions relevant du droit de la presse, a ensuite été étendue à l’ensemble des justiciables et des infractions et notamment aux actions politiques et militantes.
2 – Une confirmation du fait justificatif dans les actions militantes
Il existe déjà un précédent par lequel la Cour de cassation a estimé que la liberté d’expression pouvait être invoquée pour justifier des actions militantes de ce type.
On se souvient de l’affaire de la militante Femen qui s’était introduite au Musée Grévin pour poignarder la statue en cire d’un président russe. Fidèle au mode d’action de son collectif, la militante avait à cette occasion exhibée sa poitrine. Poursuivie pour l’infraction d’exhibitionnisme, elle avait été relaxée par la Cour d’appel de Paris.
Par un arrêt en date du 26 février 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du procureur général dirigé contre une décision de relaxe prononcée par la Cour d’appel de Paris aux motifs que :
« […] l’arrêt n’encourt pas le censure, dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression »[7].
La Cour de cassation permettait ainsi d’invoquer la liberté d’expression lorsque l’infraction répondait à une démarche de protestation politique. Dans ce cadre bien précis, la Cour de cassation demande aux juges du fond de vérifier que toute incrimination d’un acte militant ou politique de cette nature ne soit pas disproportionnée par rapport à l’exercice de la liberté d’expression.
3 – La liberté d’expression pourrait constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dans l’affaire des décrocheurs de portraits
En se référant dès son premier attendu à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation rappelle que « toute personne a droit à la liberté d’expression, et que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. »
Sur cette base et à l’appui de la jurisprudence évoquée plus haut, la Cour de cassation réaffirme que « l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause. »
Or, la Cour de cassation relève que le juge du fond[8], en condamnant les décrocheurs de portraits n’avait pas recherché si « l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus ».
En d’autres termes, elle reproche au juge du fond d’avoir opposé un refus de principe aux militants et de ne pas avoir examiné de façon concrète l’argument qu’ils avaient soulevé. Par conséquent, elle casse les condamnations pour vol en réunion et renvoie l’affaire devant une nouvelle cour d’appel qui devra rejuger ce groupe de militants prévenus.
Si la Cour de cassation n’a pas souhaité se prononcer sur le caractère disproportionné de l’incrimination au regard de l’exercice de la liberté d’expression en l’espèce, elle a renvoyé l’affaire au juge du fond pour effectuer cet examen.
À charge donc pour le juge du fond de vérifier si l’action des décrocheurs s’inscrivait dans une démarche militante ou de protestation politique et si son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
Le communiqué de presse de la Cour de cassation apporte un éclairage sur la suite de l’affaire : « La Cour de cassation ne pouvait procéder directement à cet examen qui suppose une appréciation des faits. Elle pourrait ultérieurement être amenée à contrôler elle-même le caractère proportionné d’une atteinte à la liberté d’expression au regard des circonstances de fait qui auront été établies par une cour d’appel. »
L’affaire n’est donc pas terminée. Il est possible que la Cour de cassation soit ressaisie pour établir définitivement si les décrochages des portraits présidentiels relevaient de la liberté d’expression et si leur incrimination portaient une atteinte excessive à cette liberté.
III – L’incrimination du refus de se soumettre au prélèvement ADN peut s’avérer disproportionnée dans un contexte d’action politique et militante
1 – L’infraction pénale du refus de se soumettre au prélèvement ADN
Selon l’article 706-54 du Code de procédure pénale, il est possible pour l’autorité de poursuite de prélever les « empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis » l’une des infractions limitativement énumérées à l’article 706-55 de ce même code. Parmi les infractions listées figurent le vol. Ces empreintes sont conservées dans un fichier intitulé FNAEG.
Le refus de se soumettre à ce prélèvement ADN est puni par l’article 706-56 « d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende. »
2 – Une infraction pénale critiquée jusque devant la Cour européenne des droits de l’Homme
Par une décision du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions relatives au fichier FNAEG conformes à la Constitution, sous réserve entre autres « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ».
Cependant, par un arrêt Aycaguer c. France en date du 22 juin 2017[9], la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour violation de l’article 8 de la CEDH s’agissant de la conservation des profils ADN en ce qu’elle n’offrait pas « en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante » quant au respect du droit à la vie privée dans une société démocratique.
Cette condamnation a conduit la France à modifier les dispositions relatives au FNAEG par un décret du 2 décembre 2015 pour limiter la durée de conservation des données inscrites au fichier à 25 ans et prévoir leur effacement en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Toutefois, la France n’a pas tiré toutes les conséquences de l’arrêt Aycaguer. La Cour européenne des droits de l’Homme précisait que la réserve du Conseil constitutionnel précitée n’avait pas reçu de suite appropriée :
« Ainsi, la Cour relève qu’aucune différenciation n’est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise, et ce nonobstant l’importante disparité des situations susceptibles de se présenter dans le champ d’application de l’article 706-55 du CPP. La situation du requérant en atteste, avec des agissements qui s’inscrivaient dans un contexte politique et syndical, concernant de simples coups de parapluie donnés en direction de gendarmes qui n’ont pas même été identifiés, par comparaison avec la gravité des faits susceptibles de relever des infractions particulièrement graves visées par l’article 706-55 du CPP, à l’instar notamment des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l’humanité ou de la traite des êtres humains pour ne citer que ces exemples. »
La nécessité de moduler la durée de conservation des données inscrites au FNAEG selon la gravité de l’infraction n’est toujours pas prévue en droit français malgré l’apport du décret du 2 décembre 2015.
3 – Le rôle du juge pour apprécier la proportionnalité de l’incrimination du refus de se soumettre au prélèvement ADN au regard de l’affaire en cause
A défaut de dispositions législatives satisfaisantes quant à l’infraction du refus de se soumettre au prélèvement ADN, le juge judiciaire a pris l’habitude d’examiner la proportionnalité de l’usage d’une telle incrimination.
Le tribunal de grande instance de Grenoble a ainsi relaxé un prévenu par un jugement du 3 octobre 2017 au motif que l’infraction commise par ce dernier ne faisait pas partie des infractions les plus graves visées à l’article 706-55 du code de procédure pénale.
Selon le tribunal : « la mise ne place de fichiers tels que le FNAEG constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 précité nécessaire à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les plus graves ; que de tels dispositifs ne sauraient cependant être mis en œuvre dans une logique excessive de maximalisation des informations qui y sont placées et de la durée de leur conservation ».
Dès lors, « en l’absence de durée maximale de conservation des données au sein du fichier FNAEG et de procédure d’effacement, les poursuites engagées à l’encontre de l’intéressé pour refus de se soumettre au prélèvement biologique constituent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée […] »[10].
Pour sa part, la Cour de cassation considéré dans deux arrêts du 15 janvier 2019[11] et du 28 octobre 2020[12] que ni le prélèvement ADN ni la sanction prévue en cas de refus « ne représentent une ingérence excessive dans le droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu à toute personne par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme » en raison de la possibilité pour la personne poursuivie de demander l’effacement de son empreinte génétique du fichier.
Toutefois, l’apport des arrêts du 22 septembre 2021 sur les décrocheurs de portraits présidentiels est significatif. La Cour de cassation reconnait qu’il appartient au juge du fond d’exercer « un contrôle de proportionnalité » sur l’incrimination pénale du refus de se soumettre au prélèvement ADN.
La Cour de cassation a ainsi admis que lorsque « l’infraction a été commise dans un contexte non crapuleux mais dans celui d’une action politique et militante, entreprise dans un but d’intérêt général », il existe « une disproportion entre, d’une part la faible gravité objective et relative du délit dont les intéressés étaient soupçonnés au moment de leur refus de se soumettre au prélèvement litigieux et, d’autre part, l’atteinte au respect de la vie privée consécutive à l’enregistrement au FNAEG ».
A défaut de reconnaître l’inconventionnalité persistante de l’enregistrement au FNAEG, cette décision de la Cour de cassation est louable en ce qu’elle fixe cette obligation de proportionnalité. Les actions politiques et militantes qui se traduisent par des délits de faible gravité, comme c’est le cas pour bon nombre d’actions de désobéissance civile, peuvent donc échapper au risque pour les militants de se voir exiger leur ADN. Cette position peut paraître rassurante dans une société qui se veut démocratique.
Nous retiendrons donc de cet arrêt majeur pour la désobéissance civile, (1) la toujours difficile mais pas impossible démonstration de l’état de nécessité, (2) la pertinence grandissante d’une défense fondée sur l’exercice de la liberté d’expression et (3) une certaine assurance pour se prémunir de la pratique de fichage des militants et opposants politiques, notamment de leur ADN.
[1] Tribunal judiciaire de Perpignan, 17 décembre 2020, n° 2730/2020
[2] Tribunal judiciaire de Foix, 1er juin 2021, n° 372/2021
[3] Tribunal de grande instance de Lyon, 16 février 2019, n° 19168000015
[4] CEDH, 14 juin 2013, Eon c. France, n° 26116/19
[5] Cass. crim., 26 octobre 2016, n°15-83.774
[6] Cass. crim., 24 octobre 2019, n°17-86.605
[7] Cass. crim., 26 février 2020, n°19-81.827
[8] En l’occurrence, la Cour d’appel de Bordeaux (pourvoi n°20-85.434). Le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon (pourvoi n°20-80.489) a pour sa part été déclaré irrecevable quant au moyen de la liberté expression invoqué dans la mesure où ce moyen avait été invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et non pas au préalable devant le juge du fond.
[9] CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c. France, requête n°8806/12
[10] TGI Grenoble, 3 octobre 2017, n° 2204/17/CJ
[11] Cass. crim., 15 janvier 2019, n°17-87.185
[12] Cass. crim., 28 octobre 2020, n°19-85.812